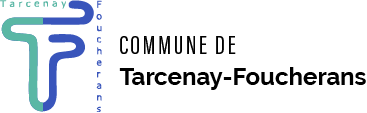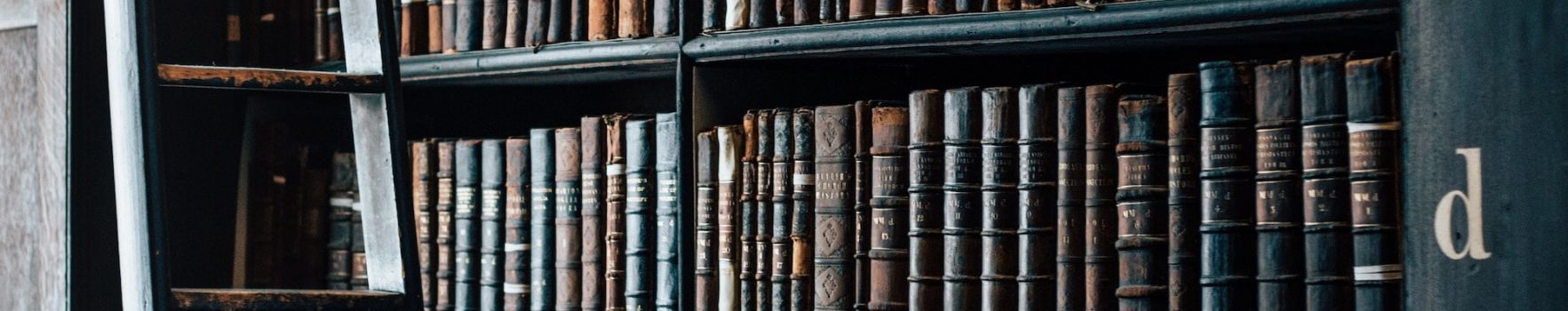Histoire de la fusion
DEUX VILLAGES, UNE COMMUNE
Au 1er janvier 2019, les communes de Tarcenay et de Foucherans se sont rapprochées pour créer une nouvelle commune « Tarcenay-Foucherans ».
Dès la promulgation de la loi PELISSARD en 2014-2015, l’idée de la mise en œuvre d’une commune nouvelle a été envisagée.
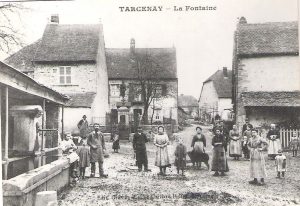
Ce projet a nécessité début 2018 une rencontre avec l’ensemble des Conseils Municipaux ainsi que des réunions publiques auprès des habitants et des associations.
Les liens qui rapprochaient déjà ces deux villages attenants étaient nombreux : l’école, la micro-crèche, les associations, les employés communaux, la gestion des équipements sportifs.
Après avoir beaucoup consulté et une étude très poussée sur les conséquences financières, à la fois pour les collectivités et pour les habitants, les derniers doutes ont été levés.
Une vraie communauté de projet s’est alors imposée entre les conseils municipaux.

Le regroupement des deux villages en un territoire unique conforte, grâce à la mutualisation des moyens financiers et logistiques, le dynamisme et l’évolution de cette nouvelle entité forte de plus de 1 573 habitants.
Les enjeux pour notre territoire et l’intérêt de cette création sont les suivants :
- être plus représentatif à la Communauté de Communes pour être véritablement acteur de notre avenir,
- pouvoir mettre en œuvre nos projets de développement grâce à un meilleur accompagnement financier (Etat : Dotation Global de Fonctionnement et Dotation aux Equipements des Territoires Ruraux, Département : C@P25),
- mutualiser nos ressources, notre personnel, pour une meilleure efficacité, et pour des services rendus à nos concitoyens plus importants et de meilleure qualité, tout en conservant une identité forte de chacun des deux villages formant cette Commune Nouvelle.
- s’engager pour la création d’un pôle unique d’enseignement, à Tarcenay, dans le cadre du protocole, signé avec l’Education Nationale, sur l’évolution de l’offre scolaire et éducative de territoire.

Après cinq ans de « vie commune », les objectifs sont atteints sur la mutualisation, sur les engagements, sur la fiscalité et surtout le respect des particularités et de l’identité de chaque village.
De plus, c’est avec plaisir que nous constatons des rapprochements au quotidien entre les habitants et les associations.
Notre souhait est de voir se multiplier ces convergences dans la mesure où elles sont choisies et librement consenties.
Faire comprendre et expliquer, faire partager sans imposer est notre feuille de route.
Toponymie des deux villages
Les toponymes pour désigner chacun des deux villages composant la commune nouvelle ont évolué au fil des siècles (d’après source Wikipédia)
Pour TARCENAY :
- Terceniaco en 1047 ;
- Tarcenais en 1148 ;
- Tersenaye au XIIIème siècle ;
- Tercennay au XIVème siècle ;
- Tarcenay en 1311 ;
- Tercenay en 1514 ;
- Tarsenay en 1665
Pour FOUCHERANS :
- Foucherans en 1134 ;
- Focherens en 1164 ;
- Foucherans en 1295 ;
- Foucherans en montagne en 1521
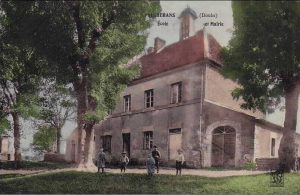

Histoire des deux villages
TARCENAY
Le nom du village, Tarceniacum, signifierait « sur un sol composé de pierres » selon l’annuaire de Doubs de 1848.
L’origine du village est ancienne mais les titres de propriété n’en font remonter l’existence qu’au Xème siècle.
Situé sur la voie de passage vers Ornans et l’Italie via la Suisse, Tarcenay a eu un château pour défendre ce point stratégique : cette maison forte, dite la Tour, vendue à un particulier au XVIIème siècle s’élevait probablement au milieu du village ; elle aurait abrité Louis XIV de passage en Franche Comté.
La révolution cause la vente des biens du curé et du chapitre. Elle sème aussi le trouble dans cette Commune catholique du plateau proche de Besançon. En 1795, le prêtre déporté Joliclerc officie dans l’église de Tarcenay et les habitants de Tarcenay se joignent à l’embuscade de la Combe Punay pour délivrer les prêtres convoyés par les soldats vers Ornans.
La localisation de Tarcenay sur une voie de communication importante explique les échauffourées de 1944 : pour ralentir l’avance américaine, les allemands bloquent la route de Trepot par des arbres sciés et se retranchent sur Charmont.
FOUCHERANS
L’origine du village de Foucherans reste incertaine.
Au XIIème siècle, une famille de Foucherans apparaît, arborant un blason (d’azur à deux bourdons d’or, ayant en chef une coquille également d’or). Un de ses membres, Renaud, fit construire un château en 1517. A ce sujet, au siècle dernier, plusieurs auteurs signalent les vestiges d’un château-fort, dont on ignore précisément l’emplacement. Situé sur un monticule peu élevé, le château-fort est mentionné en ruines en 1827 : les restes des fossés et d’une tour carrée étaient encore visibles. Le linteau de la porte portait cette inscription : « L’an 1517, fut commencé ce maisonnement, par Renaud de Foucherans ». Ce château fut probablement détruit à l’époque des guerres du XVIème siècle.
A la Révolution, les Foucheranais se montrèrent rétifs aux mesures anti-religieuses. En novembre 1791, le District d’Ornans annula les élections municipales, car on avait élu les plus fameux contre-révolutionnaires. A tel point qu’il fallut réorganiser trois fois les élections. Les Foucheranais persistèrent et le District finit par pourvoir lui-même à l’administration de la commune. En 1792, les prêtres réfractaires vinrent ouvertement célébrer la messe.
En 1795, autour de la chapelle Saint Maximin, des milliers de personnes se retrouvent pour écouter les prêtres réfractaires et jurer haine à la République. Il fallut attendre le Concordat pour que les contre-révolutionnaires apaisent leur courroux.
Le 27 janvier 1833, un important incendie détruit 10 maisons. L’année suivante, le 9 août 1834, la foudre s’abat sur le village : 15 maisons furent brûlées.
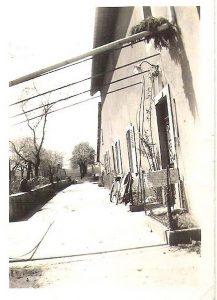


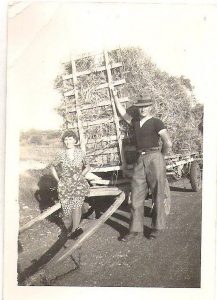
La population de Foucherans au 18e siècle
Les registres paroissiaux sont une source précieuse pour reconstituer l’histoire démographique d’un village. Bien que souvent lacunaires, ils permettent, par recoupement, d’établir l’évolution de la population, les tendances matrimoniales et les événements marquants d’une communauté. Que nous apprend l’étude du registre de Foucherans allant de 1737 à 1762 ?
Contexte historique et climatique
Sous le règne de Louis XV, la France est engagée dans plusieurs conflits, comme la guerre de succession d’Autriche (1740 – 1748) et la guerre de Sept ans (1756 -1763), bien que Foucherans semble avoir été épargné directement. La France connaît en ce 18e siècle une période marquée par le petit âge glaciaire, avec des hivers longs et rigoureux impactant les récoltes et la mortalité. Nos doyens actuels évoquent tous une abondance de neige allant jusqu’à obstruer l’entrée du village située vers le cimetière actuel. La seconde moitié du 18e siècle se distingue par une augmentation des tempêtes et ouragans.
Il semble qu’il ne reste qu’un seul témoin de cette époque : le clocher du village (1724), le reste de l’église ayant été agrandi bien plus tard.
Sur le plan fiscal, les habitants sont soumis aux lourds impôts de l’Ancien Régime : taille, dîme, capitation, corvée royale. Le village voit son économie locale animée par le commerce du bois, facilité par la route principale menant à Besançon, qui traverse Foucherans jusqu’en 1747.
Les registres paroissiaux
Les curés ont l’obligation d’inscrire chaque baptême, mariage et sépulture dans les registres paroissiaux. Rédigés majoritairement en français, certains actes anecdotiques apparaissent en latin, comme celui de la naissance d’une fille de noble de passage, dont le témoin est un chirurgien du Roi.
La précision des informations varie selon la rigueur des curés ; ceux de Foucherans se montrant plutôt concis. L’un des curés omet d’indiquer la date de deux mariages successifs, pourtant célébrés à un mois d’intervalle. Le niveau de détail des actes semble directement lié au statut des personnes concernées. Figure incontournable des registres, le recteur d’école – ou maître d’école – est présent comme témoin à chaque acte, son nom systématiquement souligné, témoignant de l’importance de son rôle au sein de la communauté.
La population
La population de Foucherans connaît une croissance spectaculaire en quelques décennies. En 1688, le village comptait seulement 12 foyers, avec une moyenne d’environ 7 personnes par foyer. En 1744, ce nombre atteint 67, soit une augmentation de plus de 450%. En moyenne, une nouvelle famille s’installait chaque année, témoignant d’un dynamisme démographique notable.
Les grandes familles d’aujourd’hui sont déjà solidement implantées à cette époque : Gauthier, Vergey, Mercier, Gounot, Allemandet, Liégeon, etc. Fait intriguant, la famille Juret, autrefois la plus nombreuse du village, a aujourd’hui complétement disparu.
L’orthographe des noms de famille varie au fil des années, laissée à la seule appréciation du curé rédigeant l’acte. Cette instabilité s’explique parle fait que les intéressés étaient souvent illettrés : 88% des femmes et 38% des hommes figurant dans les registres ne savaient ni lire ni écrire. Toutefois, l’illettrisme n’exclut pas totalement la maîtrise de l’écriture, certains parvenant à signer de façon appliquée. Il est même fort probable que le lieu-dit Jean Gonnot soit en réalité Jean Gounot. S’agit-il d’ailleurs de cet homme vivant « dans la paroisse de Foucherans » qui décède à l’âge de 80 ans en 1748 ?
Le village compte également quelques figures notables, dont le colonel Bourgon, conseiller au Parlement de Besançon. Il emploie au moins un domestique et réside au « château », une maison de maître située en face de l’ancien presbytère, où se trouve aujourd’hui la crèche.
Bien que ces actes officiels soient rédigés en français, les villageois s’expriment en patois. Grâce à la mémoire de quelques interlocuteurs encore vivants, il est possible d’en saisir quelques bribes et d’en apprécier la saveur. En voici un exemple : « Que t’fa auj’de ? (que fais-tu aujourd’hui ?). I seu au couti (je suis au jardin). Vé piochar la pommatar (je vais piocher les pommes de terre) »
L’espérance de vie
L’espérance de vie est de 35 ans pour les hommes et de 46 ans pour les femmes.
La mortalité infantile est élevée : 21% des enfants meurent avant 6 ans, et près d’un quart n’atteignent pas 18 ans ! Autrement dit, à la naissance, un enfant n’avait qu’une chance sur deux d’atteindre l’espérance de vie adulte. Le nombre de naissance est équilibré entre filles et garçons. En moyenne, le village enregistre 9 naissances et 6 décès par an, la majorité concernant les nouveau-nés.
Certains records de longévité se démarquent : Marguerite Piguet atteint 100 ans, Claude Gauthier 95 ans. Fait notable, en prenant l’espérance de vie actuelle comme référence (85 ans pour les femmes, 80 ans pour les hommes), un homme de l’époque avait dix fois plus de chance d’atteindre cet âge qu’une femme.
Naissances
Le père semble systématiquement absent lors des baptêmes, seuls les parrains et les marraines étaient présents. Il était courant, surtout en milieu rural, que les pères soient occupés par leurs tâches quotidiennes, laissant la mère, le parrain et la marraine s’occuper de l’enfant pour les actes religieux. L’enfant reçoit très souvent les prénoms de ces derniers. Les plus répandus sont alors Claude, Joseph, Jean-Baptiste pour les garçons, et Jeanne, Claude, Marguerite, Claudine pour les filles. Certains prénoms aujourd’hui disparus sont relevé : Roch, Anatoile, Ferjeux, Athanase, Dyonis pour les garçons ; Barbe, Philiberthe, Brigide, Ludovica, Dyonysée pour les filles. Par ailleurs, deux filles sont prénommées Jacques ! Elles semblent être surnommées La Jacques ou Jacquette au quotidien. Enfin, une fille Barbier est prénommée Barbe : un choix pour le moins atypique !
Deux naissances gémellaires sont recensées en 29 ans.
La natalité est particulièrement élevée en hiver et au printemps, suggérant que les conceptions avaient lieu principalement au printemps et en été. En revanche, l’automne connaît moins de naissances, possiblement en raison des conditions de vie plus rudes durant l’hiver précédent.
Le record de maternité revient à Claudine Liégeon avec 12 enfants en 22 ans. Parmi eux, deux filles sont décédées peu après la naissance et une autre durant son adolescence. Toujours en vie à la clôture du registre, elle aurait pu avoir d’autres enfants, mais cela semble peu probable en raison de son âge et d’un vide de 5 ans depuis sa dernière fille, née sans vie … L’étude du registre suivant nous en dira peut-être davantage …
Mariages et particularités
L’âge légal de la majorité est fixé à 25 ans, mais le mariage requiert l’accord des parents jusqu’à 30 ans pour les hommes et 25 ans pour les femmes.
Malgré la ferveur religieuse de l’époque, un mariage est célébré alors que l’épouse est enceinte de huit mois.
Autre anecdote : un mariage croisé. Le même jour, un Gauthier épouse une Juret, tandis qu’une Gauthier épouse un Juret.
Le recteur de l’école, déjà sexagénaire épouse une illettrée, un mariage peu commun pour l’époque !
Un foucheranais sur deux se marie avec une foucheranaise, tandis qu’une foucheranaise sur trois épouse un foucheranais. Ce déséquilibre suggère soit un manque d’hommes en âge de se marier dans le village, soit la nécessité pour les femmes de chercher un époux ailleurs, pour des raisons économiques (héritages, terres, métiers) ou sociales (proche parenté, statut, alliances familiales).
Décès et pics de mortalité
Typiquement, l’hiver et le début du printemps sont des périodes de forte mortalité.
Crises de subsistance : la famine est fréquente pendant cette période, notamment en 1753 et en 1757, où les récoltes sont mauvaises dans plusieurs régions françaises. Ces conditions auraient pu entraîner des décès supplémentaires à Foucherans. Les conditions précaires et la famine favorisent l’apparition d’épidémies. Bien qu’il n’y ait pas de preuve directe pour Foucherans, les épidémies de dysenterie et de variole étaient fréquentes dans les villages ruraux de cette époque.
Périodes critiques : 1757-1759 et 1761-1762 correspondent à des pics d’épidémies dans certaines régions françaises. Les années 1753 à 1761 voient presque le nombre de décès doubler par rapport aux autres années.
En revanche, les années 1737 et 1750 sont singulières puisqu’aucun décès n’y est recensé.
Conclusion
Qu’en est-il du registre paroissial du village de Tarcenay au 18e siècle ?
Quelle est l’histoire de la pierre tombale dressée sur la route d’Ornans ?
Où pourrait se situer le château féodal érigé en 1517 par Renaud de Foucherans ?
Est-ce bien un souterrain qui part de la plus vieille maison du village ?
A quoi a pu ressembler la vie de Quentin Sauterey ?
Autant de thèmes abordés dans une prochaine édition !
Travaux d’études et de recherches historiques sur les registres paroissiaux de 1733-1762, menés par Jonathan Bédé, habitant de la commune (avril 2025)
HISTOIRE DE SAINT-MAXIMIN
Maximin aurait été le deuxième évêque de Besançon, au cours du IIIème siècle. Après avoir confié le diocèse à son disciple Saint-Paulin, il aurait fini sa vie en ermite dans un bois qui porte aujourd’hui son nom.
Ceci est à prendre au conditionnel, car les preuves de son existence sont rares.
Un catalogue des évêques de Besançon, conservé à la bibliothèque du Vatican et provenant du scriptorium d’Hugues de Salins, mentionne Maximin en deuxième place et Paulin en troisième place. Ce sont les plus anciennes références à Saint-Maximin.
A la même période, un moine de l’abbaye Saint-Paul de Besançon rédige, dans sa Gesta Chrysopoliteanae Eclesia, des notices sur la vie des saints. Considérées par les spécialistes actuels comme hautement fantaisistes, ces notices ont contribué à la diffusion de l’histoire de Saint-Maximin. C’est sur ce texte que se basa, au début du XVIIème siècle, Jean-Jacques Chifflet pour écrire :
« Saint-Maximin fut envoyé à Vesontio et consacré évêque par le pape Caius (pape de 283 à 296). Ayant bien réglé toutes choses et ayant mis Paulin à sa place, aspirant à une vie plus solitaire, il vécut en ermite dans un bois, distant de 6 milles de la ville, où il resplendit d’une telle ardeur de vie sainte et de prédication, que la parole n’est pas capable de l’exprimer. Les chrétiens allaient nombreux le visiter dans sa solitude. Les aveugles recouvraient la vue, les malades étaient guéris de leurs maux… Un oratoire lui est maintenant consacré… et on dit que les malades de la goutte, qu’on y amène, éprouvent la puissance de Saint-Maximin. »
Ce texte a certainement été composé pour justifier la présence, à l’orée du bois au nord de Foucherans, d’une petite chapelle consacrée à Saint-Maximin en 1410 (date confirmée par un parchemin retrouvé scellé sous l’autel).
Dans le diocèse de Besançon, Saint-Maximin est fêté le 29 mai. Cette fête a été introduite dans le calendrier liturgique au XVème siècle par l’archevêque Charles de Neuchâtel, sans que l’on sache s’il s’agit de Saint-Maximin de Vesontio ou de Saint-Maximin de Trêves (évêque de Trêves vers 346). Un important pèlerinage avait lieu en cette chapelle le 29 mai.
En 1704, le pape Clément XI accorde une indulgence plénière à tous ceux qui viennent y communier.

En 1745, l’archevêque de Besançon s’indigne du fait que les pèlerinages en l’honneur des saints soient des prétextes pour remplir les cabarets et les lieux de débauche. Il écrit : « A Saint-Maximin, on n’entend que tambours et haut bois, on ne voit de tous côtés que danses et amourettes ».
En 1759, le cardinal de Choiseul, archevêque de Besançon, fait effectuer des fouilles dans la chapelle. Des ossements humains y seront retrouvés. Ceux-ci seront maintenus sur place et la chapelle sera reconsacrée à Saint-Maximin de Trêves.
En 1777, l’évêché fait transférer les ossements à l’église de Foucherans et fait démolir la chapelle. Les pèlerins continuent cependant à visiter les ruines.
Durant la Révolution, le lieu devient un point de rassemblement des catholiques, provoquant en 1795 l’envoi de commissaires de la Révolution, accompagné de la force armée.
A la fin du XIXème siècle, des notables restaurent le pèlerinage de Saint-Maximin. La chapelle est reconstruite et consacrée à Saint-Maximin de Vesontio, le 29 mai 1866, par le chanoine Besson, futur évêque de Nîmes. Le pèlerinage s’est poursuivi d’année en année, jusqu’à la fin des années 1950.